

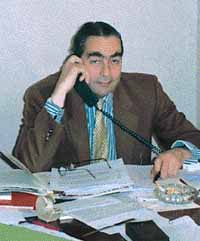
PLUS UNE MÉTHODE QU’UN CONCEPT
- Depuis plusieurs années, vous avez entrepris une réflexion
de refondation de la géopolitique. Comment définissez-vous
le concept et la méthode de cette discipline? Pourquoi un dictionnaire
de la géopolitique?
“La géopolitique est, à mes yeux, plus une méthode
qu’un concept. Au sein de la famille des sciences politiques et humaines,
son ambition est d’identifier sur la longue durée, les constances
du comportement des acteurs internationaux, essentiellement les Etats.
La géopolitique oscille entre une réflexion sur les causes
et leurs constances, sur les intentions et leurs régularités,
qu’il s’agisse des ambitions territoriales, des luttes identitaires ou
des affrontements idéologiques. En fait, la géopolitique
propose une grille de compréhension des événements
internationaux, en mettant en évidence les invariants géopolitiques
des Etats et des nations. C’est pourquoi, il a paru souhaitable de rassembler,
sous une forme pratique, dans un dictionnaire, des informations éparpillées
un peu partout, pour ne pas laisser au seul bénéfice des
spécialistes des connaissances indispensables pour comprendre l’actualité.”
UNE MÉTHODE POUR COMPRENDRE L’ACTUALITÉ
- Quels éclairages la géopolitique porte-t-elle sur
les événements internationaux et quels enseignements permet-elle
d’en tirer?
“Pour la géopolitique, l’événement, qu’il soit
politique, militaire ou diplomatique, est le résultat de plusieurs
chaînes de causalité issues de facteurs objectifs, en particulier
de la géographie et de l’Histoire. Il n’y a pas de spontanéité
dans les relations humaines entre elles. L’événement est
comme la maladie pour le médecin: il révèle des structures
anciennes qui se conflictualisent, en fonction de phénomènes
conjoncturels. Il appartient à la géopolitique d’identifier
les facteurs, de les organiser logiquement dans un ensemble porteur de
significations que j’appelle un processus.
“L’événement renvoie à des processus divers et
ces processus illuminent l’événement. Maintenant, quant à
savoir si on peut tirer un enseignement de la géopolitique, je suis
très prudent, car il n’y a pas de dogme en géopolitique qui
ramène aux réalités des peuples et des nations; elle
n’a pas de directives à donner aux hommes politiques, elle n’a que
des explications parmi d’autres à offrir.”
LES PHÉNICIENS ET LA “MONDIALISATION”
- La géopolitique est-elle une discipline d’avenir dans le
contexte d’une mondialisation que certains prétendent inéluctable
et annonciatrice de la fin de l’Histoire? En d’autres termes, la géopolitique
a-t-elle encore un sens, si notre monde est voué à devenir
un “village planétaire”?
“La mondialisation affecte, principalement, la sphère économique
et la sphère médiatique. C’est l’échange généralisé
entre les différentes parties de la planète, l’espace mondial
étant conçu en tant qu’espace libre de transaction et de
circulations des capitaux et des marchandises ce qui, du reste, n’a rien
de très nouveau puisque, dès l’Antiquité, une telle
pratique avait libre cours. Par exemple, les Phéniciens ont développé
une dynamique de “mondialisation” - dans le cadre d’un système mondial
qui était alors la Méditerranée - en installant leurs
comptoirs sur le pourtour méditerranéen et en répandant
l’alphabet commun qui favorisait les échanges et les transactions...
La géopolitique se joue sur une autre scène. Les ambitions
territoriales, les conflits nationaux et identitaires ne me paraissent
pas solubles dans le phénomène de la globalisation des échanges
commerciaux, phénomène qui est d’ailleurs beaucoup moins
identifié qu’on le pense. L’extension générale du
marché mondial et l’instantanéisation de l’information n’empêchent
pas les conflits, même s’ils peuvent intervenir, désormais,
dans la gestion même de ces conflits. On n’en finit pas si facilement
avec l’Histoire!”
LE FANTASME DU “CHOC DES CIVILISATIONS”
- Vous réfléchissez, particulièrement, sur
l’importance du facteur religieux (géopolitique de l’orthodoxie,
géopolitique du chiisme, les conflits identitaires...). Que pensez-vous
de la fameuse théorie de Samuel Huntington sur le “choc des civilisations”?
“Je me suis toujours opposé aux thèses d’Huntington.
Cela pour deux raisons. D’une part, il simplifie à l’extrême
les phénomènes socio-confessionnels, sans entrer dans le
détail. Non seulement, il globalise en réduisant arbitrairement
le monde à sept on huit entités, mais encore, il ignore l’Histoire
réelle et le poids des réalités nationales. Ainsi,
quand il parle du monde orthodoxe, il oublie que celui-ci a connu des tensions
internes majeures; par exemple les Serbes et les Bulgares se sont faits
quatre fois la guerre au XIXème siècle. Pour ce qui concerne
l’Asie, il ignore totalement les différences fondamentales qui peuvent
exister entre les Chinois, les Japonais, les Vietnamiens ou les Cambodgiens.
De même, quand il parle de l’islam, il ignore qu’il existe plusieurs
islams du point de vue religieux et, surtout, plusieurs mondes musulmans:
le monde arabo-musulman, l’Iran, le Pakistan, l’Indonésie, l’Afrique...
“D’autre part, l’autre erreur d’Huntington est d’évoluer vers
une philosophie de l’Histoire assez fantasmagorique. Par une sorte d’ensorcellement
de l’Histoire, les quelques entités qu’il décrit seraient
condamnées à s’affronter. Ainsi, quand il dit que le monde
musulman va s’allier avec le monde confucéen pour attaquer “l’Occident”,
on est en pleine fantasmagorie. D’abord, j’aimerais bien savoir ce qui
reste de confucéen dans la Chine communiste néo-capitaliste.
Ce qui est grave, c’est que ces théories, extrêmement dangereuses,
sont largement diffusées.”
LE VIEUX SPECTRE DE LA BALKANISATION DU MONDE
ARABE
- En fin de compte, les Etats-Unis se satisfont plutôt bien
des intégrismes et des extrémismes qui leur permettent de
balkaniser le monde arabe?
“C’est la thèse du général Gallois qui affirme
que les Etats-Unis ont choisi l’intégrisme, en particulier comme
gardien des routes du pétrole. Selon le général Gallois
et d’autres analystes qui n’hésitent pas à parler d’alliance
entre les Etats-Unis et l’intégrisme, les Etats-Unis s’accomoderaient
fort bien de l’intégrisme dont les principaux effets sont d’empêcher
tout développement moderne des pays concernés et de les éloigner
de l’Europe. C’est, sans doute, une thèse un peu excessive, mais
qui correspond à la réalité dans certains points.
“Concernant le monde arabe, à l’inverse du vieux plan anglo-saxon,
après la Première Guerre mondiale; puis, de celui de Kissinger
visant à créer des micro-entités ethniques ou confessionnelles
dans le monde arabe, l’enjeu pour les Arabes est, malgré les différences
très nettes qui peuvent exister entre les divers pays et, surtout,
les grandes aires comme le croissant fertile, la péninsule arabique
ou le Maghreb, de prendre conscience qu’ils sont tout de même issus
d’un tronc commun et d’essayer de construire des espaces de coopération,
notamment en matière économique.
“Après tout, cela a bien été possible pour les
nations européennes qui ont encore plus de différences. L’enjeu
est donc de faire reculer les facteurs de division et le spectre de la
balkanisation. Les conditions géopolitiques sont réunies
pour une coopération interarabe, mais toutes sortes de facteurs
internes (l’extrémisme religieux des uns qui s’oppose à la
volonté de modernité des autres) et, surtout, externes. On
peut, en effet, se demander si Washington et Tel Aviv, tous deux d’ailleurs
alliés à la Turquie, n’ont pas intérêt, d’une
part, à le balkaniser, notamment en utilisant les minorités
confessionnelles ou ethniques (les Kurdes, par exemple) et, d’autre part,
à empêcher l’émergence de projets modernes et laïcs
(on l’a bien vu avec la guerre contre l’Irak), en favorisant davantage
les systèmes conservateurs ou intégristes. On pourrait très
bien imaginer qu’il existe des scénarios visant à faire éclater
l’Irak, la Syrie, la Jordanie ou le Liban.
“Si l’on conçoit bien qu’une telle politique s’inscrit dans
la ligne traditionnelle d’Israël qui, en même temps, renforce
son alliance avec la Turquie, la vraie question est de savoir ce que veulent
réellement les Etats-Unis, à part le contrôle des zones
pétrolières. Il se trouve probablement des gens à
Washington qui hésitent à ouvrir la boîte de Pandore
d’une balkanisation qui consisterait à jouer à l’apprenti-sorcier.
Il ne faut pas non plus sous-estimer la volonté de la Russie de
reprendre de l’influence au Proche-Orient, ni le rôle actif et modérateur
de la France dans la région.
“Quant au Liban, qui a toujours été un peu le laboratoire
du monde arabe, son avenir demeure l’une des grandes questions du Proche-Orient.
Pour l’instant, malgré un renforcement de la communautarisation,
il demeure comme Etat et comme identité nationale. Cet exemple de
persistance de l’identité libanaise dans la diversité est
exemplaire et peut être porteur d’espoir pour toute la région.”