Tournant
majeur dans l’Histoire de l’humanité: la Déclaration universelle
des droits de l’homme a été votée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 au
Palais de Chaillot à Paris. 48 des 58 pays membres de l’ONU adoptaient
alors les 30 articles de cette Déclaration (traduite en 250 langues),
résultat d’un travail laborieux engagé depuis Lake Success
près de New York , du 27 janvier au 10 février 1947. Et c’est
avec fierté et émotion que l’un de ses auteurs, Eleanor Roosevelt
annonçait “une nouvelle table de la loi pour tous les hommes du
monde”.
“Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir dans un esprit de fraternité”, annonçait l’article premier
de cette Déclaration. “Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment, de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation”, précisait l’article 2.
L’article 18 reconnaissait à “toute personne humaine (le) droit
à la liberté de pensée, de conscience et de religion”
et l’article 19, le “droit à la liberté d’opinion et d’expression”
étant entendu que “nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé” (article 9) et que “nul ne sera soumis à
la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants” (article 5).
|
Photo d’archives datant du 10 décembre 1948, représentant le vote au Palais de Chaillot par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme. |
Une vue extérieure du Palais de Chaillot, le 10 décembre 1948. |
|
|
|
DES PRINCIPES BAFOUÉS MAIS QUI
FONT AUTORITÉ
Toutes sortes de guerres sont passées depuis cette date. D’autres
sont en cours. Des génocides ont endeuillé l’humanité.
Et l’homme continue à tuer, torturer, emprisonner, persécuter
l’homme. Dans son discours à l’Unesco inaugurant les cérémonies
commémoratives qui ont revêtu en France un éclat exceptionnel,
le président Jacques Chirac a reconnu que “les principes proclamés
par la Déclaration universelle des droits de l’homme sont encore
bafoués. On torture dans un Etat sur deux. La liberté d’expression
est violée. Des minorités sont persécutées”.
Mais, a-t-il ajouté, des progrès sont enregistrés
envers “les devoirs de mémoire et de réparation des victimes”
que permettra la création de la Cour criminelle internationale (décidée
en juillet dernier à Rome). Et l’on pourra aspirer à “un
nouvel ordre juridique mondial où personne, pas même les chefs
d’Etat, ne sera à l’abri de poursuites en cas de crimes contre l’humanité.”
Cependant, plutôt que de condamner, il faut tenir compte de la “diversité
des cultures”, a ajouté le chef de l’Etat français. “Nous
ne réussirons ni par la contrainte, ni en nous érigeant en
donneurs de leçons. La condamnation est nécessaire. Mais
c’est aussi par le dialogue, fut-il critique, la coopération et
l’assistance technique que nous progresserons.”
 |
|
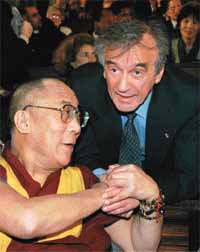 Le prix Nobel Elie Wiesel saluant un autre prix |
|
UN MILLIER DE PERSONNALITÉS RÉUNIES
À PARIS
C’est un concerto pour deux violons de Bach exécuté sous
la direction de Yehudi Menuhin, qui a donné le coup d’envoi des
cérémonies commémoratives de ce cinquantenaire auquel
ont été conviées un millier de personnalités,
venues du monde entier permettant à la France de renouer avec ses
traditions d’hospitalité et de grandeur, en association avec les
pouvoirs publics et les nombreuses organisations non gouvernementales.
Lionel Jospin qui a voulu accorder à l’événement une
dimension exceptionnelle, avait confié à Robert Badinter
une mission interministérielle pour l’organisation des manifestations
du cinquantenaire. Parallèlement aux travaux de cette mission, les
ONG réunissant Amnesty International, la Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), France-Libertés
et ATD-Quart Monde, se lançaient dans une série de travaux
en vue des états généraux convoqués pour les
8 et 9 décembre au Palais de Chaillot.
Tous les palais de la République ont ouvert leurs portes pour accueillir
les différentes manifestations. L’un des temps forts est le déjeuner
offert par le président de la République à l’Elysée
en l’honneur d’une dizaine de prix Nobel pour la paix dont le Dalaï
Lama, chef spirituel des Tibétains, en exil depuis 1951. Dans un
premier temps, l’invitation, à titre privé de ce dernier,
avait suscité une vive polémique.
L’événement majeur des célébrations était
sans contexte celui du 10 décembre, date anniversaire de la naissance
de la Déclaration ayant permis au millier d’invités réunis
au Palais de Chaillot d’acclamer, en liaison satellite, le vote par l’Assemblée
générale des Nations Unies réunie au Palais de verre
à New York, d’un texte, résultat de 13 ans de négociations,
“engageant les Etats à respecter le combat que mènent les
militants des droits de l’homme”. En même temps, était rendu
hommage à Eleanor Roosevelt et René Cassin pour leur participation
efficace à l’élaboration de la Déclaration (à
laquelle avait si activement collaboré le Libanais Charles Malek).
Autre sujet de fierté, l’adoption auparavant par la 53ème
Assemblée générale des Nations Unies de la “déclaration
sur le génome humain et les droits de l’homme”, fruit des travaux
du comité international de bioéthique présidé
par Noëlle Lenoir et qui proclame: “Chaque individu a droit au respect
de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques
génétiques.”
Il restera enfin, par-delà la fête, le sentiment que le monde,
en dépit de ses errances, est voué au respect de l’homme,
valeur centrale de l’univers.
|
Contrôle de l'application des droits
de l'Homme |
|
LES PAYS QUI ONT VOTÉ LA DÉCLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME 10 DÉCEMBRE 1948
48 pays ont voté la Déclaration universelle des droits de
l’homme: Afghanistan, Argentine, Australie, Belgique, Birmanie, Bolivie,
Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark,
République Dominicaine, Equateur, Egypte, Salvador, Ethiopie, France,
Grèce, Guatemala, Haïti, Islande, Inde, Irak, Iran, Liban,
Liberia, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua,
Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines,
Siam, Suède, Syrie, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis d’Amérique,
Uruguay, Venezuela.
Huit pays se sont abstenus: la Biélorussie, la Tchécoslovaquie,
la Pologne, l’Arabie séoudite, l’Ukraine, l’Union sud-africaine,
l’URSS et la Yougoslavie.
LES AUTEURS DU TEXTE
Parmi ceux qui ont participé à la rédaction du texte:
Eleanor Roosevelt (Etats-Unis), René Cassin (France), Peng-chun
Chang (Chine), Charles Malek (Liban), Fernand Dehousse (Belgique), Hernan
Santa Cruz (Chili), John P. Humphrey (Canada), Henri Laugier (France) et
Emile Giraud (France).