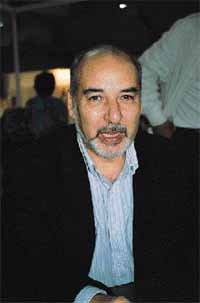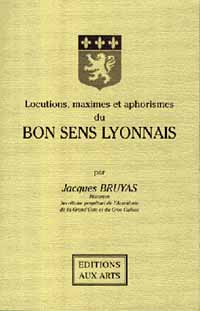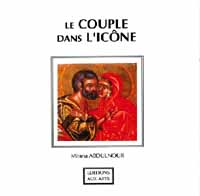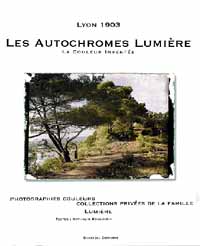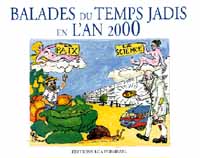"L'AUBERGE
DES PAUVRES" DE TAHAR BE JELLOUN, OU LE RELAIS DE LA FICTION.
"J'AIME RACONTER DES HISTOIRES", NOUS CONFIE LE POETE
MAROCAIN
"On n’a que
les mots pour vivre; ce sont nos amis”
“Les gens aiment la poésie, mais faut-il qu’ils y aient accès”
“Si on ne parle jamais d’un peuple, il peut disparaître. La
mémoire est une façon d’exister”.
Ce poète marocain, né à Fès en 1944, traduit
en 26 langues, écrivain francophone engagé, est habité
par les problèmes d’exil et de racisme (“On m’a collé l’étiquette
d’émigré”). C’est le moindre qui puisse être dit sur
cet auteur qui, comme il le reconnaît, “écrit pour la liberté
contre la répression”.
En visite pour la première fois au Liban, nous l’avons rencontré
au Salon “Lire en Français et en musique” où au Café
littéraire bien achalandé ce soir-là, il a livré
à ses nombreux admirateurs (trices) quelques-unes de ses réflexions
avant de signer, à la Librairie Orientale, son dernier roman édité
au Seuil: “L’auberge des pauvres”.
Calme et serein, visage souriant et regard rieur, Tahar Ben Jelloun
ressemble très peu aux héros qui hantent ses innombrables
romans aux titres évocateurs. Ses lecteurs se souviendront de “La
nuit sacrée” (l’histoire de cette fille habillée en garçon
et garde son secret) qui lui a valu le prix Goncourt en 1987 et de son
récent essai pamphlétaire sur le racisme, publié en
1998, devenu rapidement best-seller: “Le racisme expliqué à
ma fille”.
UN AUTEUR PROLIXE
Mais Tahar Ben Jelloun c’est, aussi et dans la mêlée,
“La nuit de l’erreur”, (histoire de Zeina née le jour du décès
de son grand-père et par qui le malheur arrive), “La remontée
des cendres” (écrit suite à la guerre de l’Irak), “La réclusion
solitaire” (où le héros se compare à un arbre), “La
soudure fraternelle” (en hommage à l’amitié), “Jour de silence
à Tanger” (un vieux qui parle et raconte), “La plus haute des solitudes”
(traduit la douleur des expatriés), “L’ange aveugle” (dénonce
la mafia), “L’écrivain public” (prête sa voix et sa plume
à tous les siens), “La prière de l’absent” (recueil de contes),
“Le premier amour est toujours le dernier”, “L’homme rompu”, “Les amandiers
sont morts de leurs blessures”, etc.
Dans son dernier roman “L’auberge des pauvres”, inspiré par
Naples “ville cosmopolite, lieu de tous les mélanges folkloriques,
parfois assez délirants, qui suscitent la science-fiction”, Ben
Jelloun trouve à l’hospice désaffecté des pauvres,
“lieu de rencontre des destins brisés”, “les petits faits quotidiens
pour faire des personnages vrais” et y établir la trame de son histoire.
Notamment celle d’un écrivain marocain qui n’a pas tout à
fait réussi à satisfaire ses ambitions et casse son train-train
minable, son mariage agonisant, en allant s’établir à Naples.
C’est à travers une correspondance très fictive avec
sa femme (qu’il finit par inventer de bout en bout, il lui change même
le prénom) qu’il essaye de s’inventer une autre vie pour n’en être
que plus déçu. Retourné au pays, il découvre
que son épouse l’a répudié, après avoir ficelé
et jeté à la poubelle le paquet de lettres qu’elle n’avait
même pas lues.
L’ÉCRIVAIN EST TÉMOIN DE SON
ÉPOQUE
“J’adore raconter des histoires. J’aime la fiction... Un peu comme
Shéhérazade dans les “Mille et une nuits” qui tient en main
ses lecteurs, du fait même de la menace qui pèse sur elle:
“Raconte-moi une histoire ou je te tue”. Je voudrais bien écrire
des histoires d’amour simples, mais dans la société où
nous vivons, les problèmes sont tellement grands, qu’ils ont besoin
de la littérature pour les mettre en lumière.
En 1965, j’ai vécu des situations assez stressantes au Maroc.
Je pouvais, soit agir, soit écrire. Je me suis réfugié
dans les mots. L’écriture est un exercice périlleux, dangereux
parfois. Ce qui fait peur dans les pays de dictatures et bien plus que
les sociologues, ce sont les romanciers, car les gens s’identifient aux
raconteurs. C’est parce que les écrivains arrivent à toucher
les gens qu’ils sont redoutés et mis en prison. L’écrivain
est témoin de son époque.
L’exil des Marocains et la façon dont ils ont été
reçus en France était choquante. En 1971-72, on ne parlait
jamais d’émigration. Il faut témoigner, raconter... Nommer
les choses, c’est les faire exister. Si on ne parle pas d’un peuple, il
peut disparaître. La mémoire est une façon d’exister.
Je ne peux pas oublier mes racines et mon passé, car je perdrais
une source qui m’alimente. Je n’ai pas d’ambiguïté sur mon
identité, mais je ne peux pas accepter qu’on impose à l’écrivain
une loge de concierge, de réfugié. S’il est sincère,
il peut aller très haut et très loin.
LE RACISME N’EST PAS DANS LA NATURE HUMAINE
“Le racisme expliqué à ma fille” (publié en 1998
très vite devenu best-seller, 400.000 ouvrages en France, 300.000
en Italie, 100.000 en Allemagne… traduit même en braille) répondait,
simplement, à une question posée par ma fille de dix ans.
Pourtant, avant de publier cet ouvrage, tout semblait évident. Mais
avec le recul, décrire aux jeunes une notion aussi importante s’est
avéré être un long travail, précis et clair,
qui a exigé plusieurs versions après consultations de nombreux
enfants, mais surtout des biologistes, des professeurs, des amis.
Le racisme est, souvent, une réaction primaire générée
par la peur, l’angoisse, la déception. La colonisation est déjà
un premier pas raciste d’un Etat vers un autre. Mépriser pour dominer
est le premier geste raciste. Mais je demeure optimiste. On ne naît
pas raciste; on le devient. Les enfants ne le sont pas; ce sont leurs parents
qui le sont. C’est pour cela que j’ai écrit ce livre, car un enfant
peut changer, mais pas un homme ou une femme de 40 ans”.
“L’écrivain est un aveugle qui a le pouvoir de voyance; lui,
aussi, invente des personnages, un monde particulier et vit avec des ombres,
comme si elles étaient des corps pleins et vivants. Il regarde le
monde, l’observe; puis, se retire dans la solitude et ferme les yeux pour
écrire. Il imagine, c’est-à-dire qu’à partir des débris
de ce qu’il a enregistré, il fabrique un univers”.
SUR LA TRADITION ORALE MAROCAINE
“Il existe au Maroc, un imaginaire populaire très varié
et très riche. Il est imprévisible et va au-delà de
toute logique. Il nourrit la fiction. C’est lui qui se montre, se met en
scène dans les contes merveilleux ou cruels, lance des pièges
à l’écrivain et au lecteur. Il les met au défi de
le dépasser, d’être plus fort que sa folie, plus incroyable
que ses extravagances.
Cet imaginaire est en perpétuel changement. Il est vivant, épouse
l’époque et ses incohérences, le temps et ses blessures.
Sa passion est de surprendre, d’être en avance sur les catégories
du convenable. Quand on est écrivain, c’est une chance que d’appartenir
à ce pays où la tradition orale est plus forte que celle
de l’écrit. Elle est plus facile d’accès.
“L’engagement de celui qui écrit n’est pas dans la multiplication
des mots à résonance adéquate, ni dans la répétition
des phrases et slogans séduisants. Son engagement est dans la sincérité.
La sincérité de transmettre avec fidélité ce
que son regard a vu, ce qu’il a traversé, ce qu’il a saisi derrière
les mots et les voiles.

Home