 Par
Carma KARAM
Par
Carma KARAM
LES PROGRÈS DE LA MÉDECINE VONT CHANGER VOTRE VIE... N’ATTENDEZ PAS POUR SAVOIR!
L’INFARCTUS SANS DOULEUR
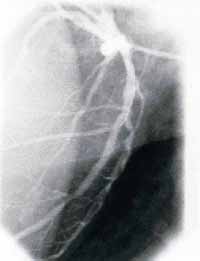
 Par
Carma KARAM
Par
Carma KARAM
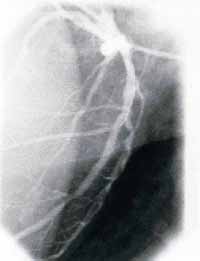
Une étude réalisée sur 434.877 victimes de crise cardiaque a révélé qu’un tiers d’entre elles sont arrivées à l’hôpital sans avoir de douleur dans la poitrine. Ces personnes ont deux fois moins de chance de survivre pour deux raisons: souvent, elles arrivent plus tard aux urgences (2 heures de plus! ) et l’absence de douleur fait que le médecin ne pense pas tout de suite à l’infarctus. Chez les diabétiques, ce problème était déjà connu - on pense que le diabète abîme les nerfs du cœur qu’il rend donc moins sensibles à la douleur -, mais l’ampleur du phénomène a de quoi étonner. Car trente-trois pour cent, ce n’est pas rien. L’étude parue dans le Journal of the American Medical Association a été réalisée sur des dossiers obtenus dans 1674 hôpitaux à travers les Etats-Unis, doit conduire à être encore plus prudent et à penser systématiquement à l’infarctus, surtout si la personne est à risque. Qui risque justement d’avoir un infarctus sans douleur? Les femmes, les personnes de plus de 75 ans, les insuffisants cardiaques et les diabétiques. Des signes moins typiques comme le souffle court, le pouls irrégulier, l’anxiété, les nausées, l’évanouissement ou une fatigabilité très importante doivent attirer l’attention. Surtout que l’infarctus est loin d’être une mince affaire : parmi les 1.100.000 Américains touchés chaque année, 40% vont mourir. Pire : en l’absence de douleur, la mortalité à l’hôpital est de 23% contre 9% avec douleur. Car quand le diagnostic est fait tard, le patient ne peut plus bénéficier des traitements de pointe comme les médicaments qui permettent de dissoudre les caillots ou mieux, l’angioplastie au ballon (parfois avec mise d’un stent) qui permet d’ouvrir rapidement l’artère bouchée. Rappelons qu’un infarctus survient quand un caillot de sang se forme dans une artère déjà rétrécie par des dépôts de cholestérol et de graisse, empêchant le sang et l’oxygène d’arriver au muscle cardiaque. Les dégâts se constituent, surtout, pendant les six premières heures, c’est pourquoi il vaut mieux ouvrir l’artère au plus tôt.
Uprima, le premier concurrent sérieux du Viagra, mise au point par le laboratoire TAP Pharmaceuticals, a été retirée très tôt de la compétition. Et ce, en raison d'effets secondaires importants apparus lors des tests chez l’homme : une personne sur 30 a perdu connaissance ou a subi une forte baisse de tension artérielle en utilisant la dose maximale du médicament. Un homme a eu un accident de voiture et un autre a fait une chute avec fracture du crâne. C’est pourquoi, les producteurs d’Uprima ont préféré ne pas la proposer à la vente et revoir leur copie. Depuis que le Viagra a occupé le terrain du traitement de l’impuissance en 1998, la concurrence est ouverte. D’autant plus que tous les hommes ne répondent pas à la pilule bleue de chez Pfizer. Le Viagra a causé des morts, en particulier en cas d’association avec les dérivés nitrés, contenus dans les médicaments contre l’angine de poitrine ou maladie des artères coronaires. Il a aussi déclenché des crises cardiaques. Sur une étude réalisée sur 3000 patients, Uprima n’aurait provoqué aucun décès ou crise cardiaque. Par contre, 4 personnes sur 1000 ont perdu connaissance. Cela viendrait du fait que les deux médicaments ne fonctionnent pas de la même façon : le Viagra augmente le débit sanguin dans le pénis, alors qu’Uprima augmente le taux d’une substance chimique du cerveau qu’on pense jouer un rôle important dans la provocation des érections. Les laboratoires TAP, résultant de la fusion des laboratoires Abbott et de Takeda Pharmaceuticals, qui croient en l’efficacité de leur produit, veulent continuer les tests avant de resoumettre le dossier devant la FDA, commission américaine du médicament.

Le paludisme ou malaria est transmis par la piqûre d’un moustique appelé anophèle. Il sévit dans 103 pays et concerne donc plus de 2 milliards et demie de personnes. Il est responsable de 1 à 3 millions de décès par an! Il est présent dans la plupart des régions tropicales du globe : Afrique subsaharienne, Nouvelle-Guinée, Haïti, Amérique Centrale, Inde, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Océanie. Le plasmodium est le nom du parasite qui infecte l’homme et il en existe quatre espèces dont la plus virulente est le plasmodium falciparum. Les parasites, qui sont dans les glandes salivaires de l’anophèle sont inoculés à l’homme par la piqûre du moustique. Le sang les conduit vers le foie où elles peuvent se multiplier jusqu’à faire éclater les cellules du foie et être à nouveau libérées en très grand nombre dans le sang où elles vont coloniser et détruire les globules rouges. Tout commence par une fièvre, des maux de tête, une fatigue, des nausées, des douleurs musculaires, puis des frissons. Mais cela peut mener rapidement à un coma, une insuffisance rénale, une anémie sévère, un état de choc et une détresse respiratoire. La vue au microscope des parasites dans les globules rouges sur un étalement de sang permet de faire le diagnostic de paludisme (photos). Le traitement classique est la chloroquine, mais des résistances à ce médicament sont devenues très répandues surtout en Afrique. Les médicaments de remplacement sont trop chers pour pouvoir soigner tout le monde. Tout récemment, une étude parue dans le magazine Science nous apprend que des chercheurs ont réussi à transformer, génétiquement, une variété de moustique, à lui faire transporter le plasmodium et à infecter des poulets. Cela devrait permettre de suivre les différentes étapes de l’infection et du développement des parasites pour tenter de bloquer le cycle de reproduction du plasmodium. Ils espèrent, également, fabriquer des moustiques mutants résistants au paludisme (c’est-à-dire qui ne seraient plus infectés et donc ne contamineraient plus l’homme) qui seraient relâchés dans la nature pour remplacer les autres espèces. Modifier le cycle de la nature est un projet ambitieux qui pourrait rapidement voir le jour et, s’il est efficace, permettre de gagner la première manche face à la malaria.